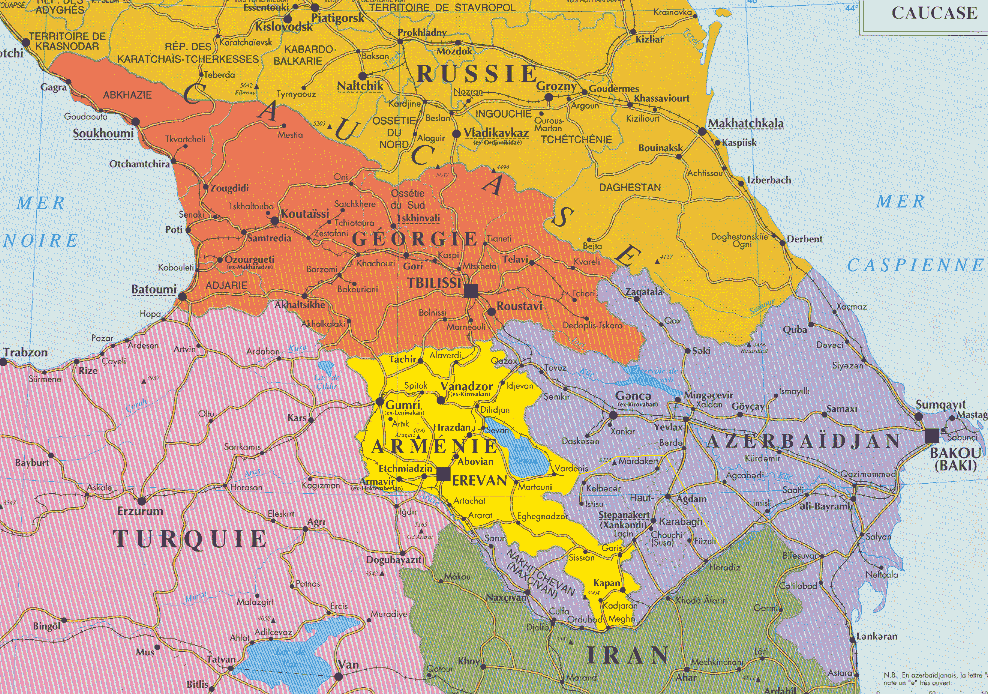
Les trois États subcaucasiens lors de l'indépendance en 1991, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Source : Ministère français des Affaires Étrangères. ©DR
Universitaires et professionnels du patrimoine européens, russes et originaires du Sud-Caucase se sont réunis (en ligne) le 15 avril 2021 à l’initiative de l’Institut national du patrimoine (France). Cette journée d’étude intitulée « La protection du patrimoine culturel du sud Caucase » a permis aux trois États de la région - Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie - de présenter leurs politiques publiques en matière de conservation du patrimoine dans un contexte tendu où, après une victoire militaire au Karabagh, l’Azerbaïdjan cherche à catégoriser des églises arméniennes comme oudies et albaniennes, effaçant une présence arménienne pourtant millénaire et attestée. Jean-Pierre Mahé, académicien, grand spécialiste de la région, a rappelé dans son discours d’ouverture la richesse des patrimoines de Subcaucasie et la nécessité de les protéger dans le respect de leur histoire, car elles appartiennent au patrimoine de l’humanité. Retrouvez l’intégralité de cette allocution d’une grande ampleur, restituant l'histoire du patrimoine du Karabagh et de la région dans toute sa complexité à partir des sources dont dispose la recherche aujourd'hui.
Par Jean-Pierre Mahé, membre de l’Institut de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
La Subcaucasie. Patrimoines et polyphonie culturelle
Certains pays d’Asie, du Proche ou du Moyen Orient, sont comme des portes ouvertes sur l’abîme des siècles ou des millénaires. Le temps y semble plus dense et plus profond qu’ailleurs. Les trois États subcaucasiens, qui s’étendent entre la Mer Noire et la Mer Caspienne, Géorgie, Azerbaïdjan et Arménie, offrent tout à la fois les vestiges vivants d’un univers englouti et une aire géostratégique à la lisière des mondes, constamment exposée aux flux des échanges, à la concurrence des langues, à l’affrontement des civilisations et des cultures.
Au nord, ils avoisinent les cimes les plus hautes de l’ancien monde occidental, la chaine du Grand Caucase, où les premiers historiens des conquêtes d’Alexandre virent souvent le prolongement occidental de l’Himalaya. Quand on emprunte la route militaire des Ossètes, depuis Tbilisi jusqu’à Kasbégi, et qu’on prend un 4/4 pour atteindre l’église de la Trinité (Saméba), on arrive au mont Gergeti. En dessous de cet énorme pic rocheux, repose le Prométhée géorgien, Amirani, enchaîné dans une caverne. La masse de la montagne l’empêche de sortir, de crainte qu’il ne provoque à nouveau le Créateur et n’entreprenne de construire un monde meilleur, d’un bout à l’autre de l’isthme subcaucasien.
Tout en contraste avec ces luttes titanesques, gigantomachies des origines, les antiques royaumes subcaucasiens voisinent au sud et sud-est avec le croissant fertile syro-mésopotamien d’où a émergé la civilisation, cinq à six mille ans avant notre ère. Partout subsistent des monuments antiques et médiévaux, mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg. Le sol qui bruit sous les pas des vivants recèle tant de témoins d’époques disparues !
C’est à Dmanisi, au sud-ouest de Tbilisi, qu’on a retrouvé les plus vieux ossements humains d’Eurasie. Ils s’inscrivent sur l’itinéraire qui conduisit, par glissements insensibles, de génération en génération, sur des millions d’années, les plus anciens représentants de notre espèce, partis de leur berceau africain, à travers le Proche Orient et le Caucase, jusqu’à l’Europe et les profondeurs de l’Asie.
Mais les montagnes et les vallées subcaucasiennes abondent en alignements et en vestiges préhistoriques. Les pierres taillées ou polies, les outils métalliques, les poteries, permettent d’établir la chronologie relative de ces sites sur plusieurs millénaires. On arrive ainsi aux périodes ourartienne, puis perse-achéménide, et aux antiquités hellénistiques et romaines. Viennent enfin les monuments païens, zoroastriens, chrétiens ou musulmans, qui affleurent en surface ou sont intégralement conservés. Ils ponctuent l’histoire des deux millénaires de l’ère commune, rythment la vie des habitants, et attirent de nos jours des flots de visiteurs étrangers.
Cette profusion architecturale est le rayonnement d’un trésor impalpable et profondément humain. Le géographe Strabon rapportait la rumeur qu’au marché de Dioscurias – l’actuelle Soxumi – on parlait plus de trois cents langues différentes. Ce nombre, qu’il jugeait excessif, n’est nullement démenti par la linguistique moderne. Bien au contraire ! Il est vrai que cette polyglottie est plus accentuée au nord qu’au sud de la chaine du Grand Caucase, parce que les sociétés humaines du sud furent plus promptes que celles du nord à passer des structures tribales aux États organisés.
Ainsi, au cours de ses campagnes militaires dans le Caucase, en 66-65 avant notre ère, Pompée affronta les royaumes d’Arménie, d’Ibérie (c’est-à-dire de Géorgie orientale) et d’Albanie caucasienne, qui correspondent approximativement aux trois Républiques actuelles de Géorgie, d’Azerbaïdjan et d’Arménie.
Pour en venir à la situation actuelle de la Subcaucasie, elle recèle, à elle seule, une complexité ethno-linguistique beaucoup plus riche que ne le laisserait supposer le nom des trois États qui la composent. Certes, chacun d’eux a sa langue officielle : l’arménien, le géorgien et l’azéri. Mais observons que ces trois langues, qui n’ont entre elles aucune origine commune, cohabitent avec d’autres parlers minoritaires.
*
Le géorgien est une langue caucasique, c’est-à-dire autochtone du Caucase. Très largement majoritaire, cette ancienne langue de culture comporte encore plusieurs dialectes montagnards, et voisine avec pas moins de sept langues d’origines diverses. Tout d’abord, la branche sud-caucasique, à laquelle appartient le géorgien, comporte trois autres langues vivantes actuellement parlées sur le territoire de la République de Géorgie : le svane, le laze et le mingrèle. D’autre part deux communautés linguistiques, les Abkhazes et les Ossètes, ont soulevé des revendications séparatistes. Enfin, d’autres langues, très minoritaires en Géorgie, comme l’arménien et l’azéri, sont arrivées plus tardivement, notamment à la faveur de la conquête russe du Caucase, de 1802 à 1869.
Nombreux à Tbilisi jusqu’au début du XXe siècle, beaucoup d’Arméniens sont ensuite passés en Arménie. Les populations arméniennes encore regroupées dans la province géorgienne du Djavakhéti – le pays de l’orge –, près d’Akhalkalaki et d’Akhaltsikhé, où elles ont conservé jusqu’à ce jour un patrimoine architectural très intéressant, représentent un cas particulier. L’immigration des Azéris en Géorgie est dans l’ensemble plus récente.
Au contraire du géorgien, l’arménien n’est pas une langue autochtone du Caucase. C’est un idiome indo-européen que les recherches comparatives les plus récentes rattachent à la branche balkanique, avec le grec et l’albanais. Sur le territoire résiduel qu’ils occupent aujourd’hui – à peine le dixième de l’Arménie antique et médiévale – les Arméniens constituent plus de 95 % de la population.
Mais ils côtoient encore une minorité linguistique nettement identifiable : les Kurdes Yazidi de Ria Taza et des environs. Ceux-ci, descendants des Cardouques de Xénophon, ont gardé la religion dualiste de leurs ancêtres et continuent de parler, outre l’arménien, une langue iranienne qui leur est propre. Leurs tombes sont souvent marquées de figures sculptées, béliers ou chevaux, chargés de conduire l’âme dans l’autre monde. Les nombreux villages azéris, enclavés naguère dans le territoire de la RSS d’Arménie, ont été évacués pendant les premières années de l’indépendance en 1991.
L’Azerbaïdjan abrite, lui aussi, une grande diversité ethnolinguistique. Ce qui rend difficile à saisir la transition de l’Albanie caucasienne à l’Azerbaïdjan actuel, c’est que l’Albanie préislamique était loin d’avoir une structure étatique homogène. Elle était composée de deux territoires entièrement différents de part et d’autre de la Kura. Au nord, sur la rive gauche du fleuve, s’étendait l’Albanie des origines, parlant divers dialectes albaniens apparentés à l’udi, encore en usage aujourd’hui dans deux villages d’Azerbaïdjan et un village de Géorgie. Au sud, sur la rive droite de la Kura, les deux provinces arméniennes d’Utik‘ et d’Arc‘ax (l’actuel Karabagh) avaient été transférées successivement, en 428 et en 451, par les Perses sassanides à un royaume de nouvelle Albanie, deux fois plus grand que l’ancien, aux dépens des Arméniens. Dans cette structure politique artificielle, l’écart de civilisation était considérable entre le nord albanophone, où l’architecture monumentale était fort peu développée, et le sud arménophone, déjà couvert de bâtiments civils et religieux.
Certes, depuis 420-430, les clercs albaniens, au nord de la Kura, disposaient, grâce à un l’alphabet de 52 lettres, créé spécialement pour eux par l’Arménien Maštoc‘, d’une version de la Bible et des Évangiles dans leur langue nationale. Mais l’albanien tomba en désuétude vers le IXe siècle.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, toute trace de cette langue resta inaccessible. En 1975, un incendie, survenu dans le Sinaï, à des milliers de kilomètres de Kish, « la mère de toutes les églises albaniennes », permit de découvrir, dans une véritable génizah, un cimetière de livres saints, cachés dans la muraille du monastère de Sainte-Catherine, deux palimpsestes écrits dans une langue inconnue, que le savant géorgien Zaza Aleksidzé identifia en 1991 comme étant l’albanien.
On y lit uniquement des textes bibliques, mais aucune vie de saint et aucune chronique. On en déduit qu’à la fin du IXe siècle, il n’existait pas encore en Albanie caucasienne une littérature chrétienne comparable à celle de l’Arménie ou de la Géorgie, à la même époque. Les seules chroniques qui nous fassent connaitre l’Albanie préislamique sont en arménien.
Néanmoins, au Ve siècle, le développement simultané des trois alphabets chrétiens de Subcaucasie conduisit à l’élaboration d’une culture religieuse convergente sur certains axes essentiels. Ce processus unitaire, favorisé dans la seconde moitié du Ve siècle par les pressions et les persécutions zoroastriennes des Perses sassanides, déclina, à partir du VIe siècle, à cause des querelles christologiques, puis à partir de 639, à cause de l’expansion de l’islam.
Dans la situation actuelle, sous l’uniformité officielle de la langue azérie, d’origine turcique, persistent divers multilinguismes, dont les racines sont parfois très anciennes. Sur les pentes méridionales du Grand Caucase, au sud du Daghestan, vivent de part et d’autre de la frontière russe, des communautés autochtones parlant des langues nord-est caucasiques, comme le daghestani, le lezghien, le darghien, le lek, le rutule et le tabassaran. Les Tates et les Talyches constituent, en Azerbaïdjan, des îlots iraniens, dont la langue s’apparente à l’ancien persan. En dehors du Karabagh, les Arméniens, à la fin de la période soviétique, étaient encore présents à Gandja et à Soumgaït, cité ouvrière au nord-ouest de Bakou.
*
Ainsi, malgré l’homogénéité que les trois États subcaucasiens revendiquent, chacun de son côté, au nom de la nation qu’ils représentent, ils sont dépositaires d’un patrimoine multiethnique qui déborde largement leur propre identité. Comment pourrait-il en être autrement dans une région du monde si proche des civilisations les plus anciennes ? Le cas de l’Arménie, de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan est, à certains égards, assez comparable à celui de l’Irak, de la Syrie ou de l’Égypte, qui doivent gérer à la fois leur propre identité actuelle, celle des diverses communautés établies dans leur territoire depuis une vénérable antiquité jusqu’aux derniers soubresauts des XXe et XXIe siècles, ainsi que le prestigieux héritage d’un passé qui relève du patrimoine de l’humanité.
De même, les sites ourartiens de la République d’Arménie, qui datent du Ier millénaire avant notre ère, font la fierté de tous les Arméniens, bien qu’ils n’aient aucun lien direct avec les origines de leur nation. La ville de Tbilisi, capitale historique de la Géorgie, a aussi été le siège, du IXe au XIe siècle, de l’Émirat arabe djafaride. Elle contient jusqu’à aujourd’hui des monuments civils et religieux géorgiens, arméniens, zoroastriens, juifs et musulmans. De son côté, Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, brille toujours de l’éclat, largement international, de la ville où sont nées les techniques d’extraction, de raffinage, d’utilisation industrielle du pétrole.
La conservation et la mise en valeur des multiples facettes d’un patrimoine si divers et d’une telle profondeur chronologique est rendue particulièrement délicate par l’intensité des tensions interethniques sous-jacentes, étroitement imbriquées les unes dans les autres. Il n’existe évidemment pas de remède miracle permettant de les soulager. Mais il n’est sans doute pas inutile de connaitre les circonstances dans lesquelles ces désaccords sont apparus, ainsi que les périodes de détente et de conciliation.
Les premiers rois chrétiens d’Arménie et de Géorgie, Tiridate et Mirian, nouèrent des liens d’amitié. Tiridate maria sa fille, Salomé au fils du roi de Géorgie. Salomé devint la plus fervente disciple de sainte Nino, la catéchète des Géorgiens.
Dès la mort de ces pionniers de la christianisation, des légendes hagiographiques se formèrent pour perpétuer leur mémoire et consolider les liens entre les deux royaumes. On prétendit que sainte Nino, avant de venir en Géorgie, avait appartenu au groupe de religieuses qui suivaient Hṙip‘simē, la vierge « romaine » (c’est-à-dire byzantine), dont le martyre et les effrayants prodiges qui en avaient résulté avaient provoqué le repentir et la conversion du roi Tiridate. C’est ainsi que, dès la fin du IVe siècle, un pèlerinage arméno-géorgien s’établit entre la chapelle de sainte Hṙip‘simē, près de la cathédrale arménienne d’Ējmiacin, et la sainte croix, érigée par Nino sur la colline de Djvari, qui domine Mcxeta, berceau de la foi géorgienne.
Les pèlerins arméniens qui partaient pour la Géorgie s’arrêtaient à mi-route sur la tombe de leur compatriote, sainte Šušanik, martyrisée en 467 à Curtav, par son criminel époux, le renégat Varsken. Son père, prince de Gogarène, une marche frontalière entre l’Arménie et la Géorgie, avait accueilli, après 451, les veuves et les enfants des héros arméniens, morts pour la foi en combattant les Perses zoroastriens.
On pourrait encore évoquer d’autres buts de pèlerinage tendant à rapprocher l’Arménie de l’Albanie caucasienne : ainsi, la tombe et les reliques de Grigoris, petit-fils de saint Grégoire l’Illuminateur, le premier patriarche de l’Arménie. Attaché à la queue d’un cheval lancé au galop, Grigoris mourut en martyr sur les rives de la Mer Caspienne. Mais ses reliques, miraculeusement retrouvées par le roi d’Albanie, Vač‘agan le Pieux, furent déposées dans un mausolée, au bourg d’Amaras, dans l’actuel Karabagh.
Pourtant les liens puissants instaurés entre les trois chrétientés caucasiennes par ces pieuses légendes s’affaiblirent peu à peu dans la première moitié du VIe siècle, à l’occasion des disputes christologiques suscitées par le concile de Chalcédoine. Sans exposer le fond théologique du problème, nous observerons simplement que le choix de prêter au Christ une seule nature divine, ou deux natures, l’une divine et l’autre humaine, revenait, pour une société chrétienne, à opter, dans le premier cas, pour l’intégrisme, en substituant la loi religieuse à la coutume profane, et dans le second cas, à distinguer rigoureusement le sacré du profane, et l’autorité de l’Église du pouvoir de l’État.
L’éclatement, au début du VIIe siècle, de l’unité des trois chrétientés subcaucasiennes a eu des conséquences culturelles et géopolitiques qui se font sentir jusqu’à nos jours. Alors que, tous ensemble, les trois États avaient efficacement résisté aux pressions des Sassanides, ils furent affaiblis par leurs divisions en face de l’islam. La Géorgie et l’Arménie existent toujours comme des États chrétiens, mais il ne reste plus, en Azerbaïdjan, que des traces résiduelles de l’ancien christianisme albanien.
Sur le plan patrimonial, la convergence qu’on observait durant la période préislamique, entre l’architecture et les autres arts appliqués, dans les trois royaumes du Caucase, s’est manifestement rompue. Le trait le plus visible est la place et le rôle des images. À l’époque ancienne, toutes les églises étaient peintes, en Arménie comme en Géorgie, et probablement en Albanie, quoiqu’on manque aujourd’hui d’exemples anciens. Pour des raisons théologiques, le catholicos arménien, Jean d’Ōjun, qui a fixé le dogme de son Église au début du VIIIe siècle, a proscrit les fresques et remplacé les icônes par des croix.
Au contraire, en Géorgie, les icônes sont présentes dans toutes les églises, dont l’intérieur est entièrement revêtu de fresques. Parallèlement, l’une des chroniques arméniennes concernant l’Albanie raconte comment l’évêque albanien Israyēl convertit le prince des Huns de la Mer Caspienne, Alp Iltver, et remplaça les arbres sacrés des païens par de grandes croix historiées couvertes d’images peintes et de décors en métal précieux. Ce type de croix figuratives, qui existe aussi en Géorgie, contraste avec les croix aniconiques des Arméniens, notamment les xač‘k‘ar, stèles de pierre sculptée marquées du signe abstrait du Fils de l’Homme.
À partir des IXe-Xe siècles, l’architecture religieuse géorgienne se développe dans des directions très différentes de l’architecture arménienne, aussi bien pour le décor des façades que pour l’expansion des volumes, et le choix même du plan. Un examen précis de toutes ces différences révélerait, à chaque fois, des motifs liés à des spécificités doctrinales. On pourrait enfin opposer la monodie des offices arméniens à la polyphonie des célébrations géorgiennes.
La portée intellectuelle de tous ces contrastes déborde de beaucoup le champ artistique. On y perçoit l’écho de profondes divergences sur la conception du monde, sur l’interprétation du culte, sur l’appréhension des rapports avec le divin. Nécessairement dans une société chrétienne médiévale, ces écarts retentissent sur la vie profane et sacrée, sur les mentalités des clercs et des laïcs, sur l’horizon mental de l’époque et de la collectivité dans son ensemble.
Limitons-nous à une seule remarque. Au début du XIXe siècle, Xač‘atur Abovian, fondateur de la littérature arménienne orientale moderne et contemporaine, déplorait qu’il n’existât encore à son époque aucun livre arménien qui ne fût pas ecclésiastique – rien de comparable aux romans européens. En Géorgie, ce genre de textes existait au moins depuis le XIIIe siècle. Le plus grand poète géorgien est Šota Rustavéli, sans doute contemporain de la reine Tamar († 1213), qui relate, dans son Chevalier à la peau de panthère, les aventures de deux héros, partis à la recherche d’une bien-aimée mystérieusement disparue.
Nul doute que le dogme chalcédonien des deux natures, divine et humaine, du Christ, n’ait créé les conditions culturelles qui permirent à l’auteur géorgien d’écrire ce texte résolument profane, d’ailleurs inspiré d’un célèbre poème persan de Nizami de Gandja, dans l’actuel Azerbaïdjan. Mieux encore, en situant son roman à l’étranger, dans le monde musulman, Rustavéli prête à ses personnages un comportement tout à fait affranchi de la tutelle des clercs et des moeurs chrétiennes. On voit donc le fossé qui se creuse, dès cette époque, entre les mentalités arménienne et géorgienne. Les provinces méridionales de l’Albanie caucasienne sont incluses, aux XIIe-XIIIe siècles, dans l’Arménie zakaride ; au nord, l’ancienne Albanie est passée à l’islam.
*
En effet, la défaite des Perses sassanides, à la bataille d’al-Qadisiyya, en 637, a gravement fragilisé la position géostratégique des trois chrétientés subcaucasiennes. D’un coup, l’expansion de l’islam les a exposées aux attaques arabes, non seulement du sud, mais du sud-est. C’est de l’Adharbaydjân, la région de Tabriz, conquise par les Arabes en 639-641, que partit vers 650 l’assaut des troupes califales, qui contraignit, entre 652 et 655, les princes chrétiens de Subcaucasie à signer des accords de sauvegarde, qui faisaient d’eux des dhimmi tributaires de l’islam.
Sous le califat umayyade (vers 637-750), dominé par les Arabes de souche (par opposition aux convertis), la province d’Arminîya, réunissant l’Arménie, la Géorgie orientale et l’Albanie caucasienne, avait pour capitale la ville de Duin, dans la plaine de l’Araxe. C’était le siège du gouverneur arabe, qui traitait avec les princes délégués par la noblesse de leur nation. Mais au milieu du VIIIe siècle, les califes abbassides, successeurs des Umayyades, fixèrent leur siège à Bagdad et, en 789, le gouverneur arabe de la province caucasienne transféra sa résidence à Barda, au cœur de l’actuel Azerbaïdjan, qui ne tarda pas à être annexé, ainsi que Ganja, à l’Adharbaydjân musulman.
Dès la fin du VIIIe siècle, la Subcaucasie, cernée à l’est et au nord-est par l’expansion de l’islam, semblait menacée de devenir un îlot de christianisme de plus en plus réduit dans l’océan du califat. Ce péril, qui semblait imminent vers le milieu du IXe siècle, fut différé de plus d’un demi-millénaire par le déclin du califat et la restauration des royaumes d’Arménie et de Géorgie. Au cours du XVIe siècle, l’encerclement des États chrétiens du Caucase devint complet. Vers 1635, les Perses safavides et les Turcs ottomans se partagèrent l’Arménie, directement incorporée à leurs domaines, et contrôlèrent étroitement la Géorgie orientale, attribuée à la Perse, et les principautés de Géorgie occidentale, sous la dépendance du sultan.
Vers 779, l’historien arménien, Łewond, reconnaissait, dans l’expansion de l’islam, un processus mondial irréversible. À ses yeux, la nécessaire coexistence entre chrétiens et musulmans se limitait au strict respect de la liberté des cultes. C’est au roi de Géorgie, David le Reconstructeur (1089-1125) qu’il revint de définir précisément les pratiques judiciaires et administratives qui lui permirent d’organiser tout l’espace subcaucasien comme une confédération multiethnique et pluriconfessionnelle, réunissant sous son autorité les croyants des trois religions monothéistes. Montrant l’exemple, le roi participait personnellement à tous les cultes : le vendredi à la mosquée, le samedi à la synagogue, et le dimanche à l’église.
Resté en vigueur jusqu’à l’éclatement du royaume unifié de Géorgie en 1443, ce système n’a malheureusement pas eu de postérité jusqu’à nos jours. Au XIXe siècle, tout en pratiquant une politique de russification, l’Empire des tsars n’a hélas pas manqué, dans les périodes de crise (par exemple la Révolution de 1905) d’attiser les tensions interethniques, incitant les uns à massacrer les autres, sous prétexte de rétablir l’ordre.
C’est pourquoi, au cours de l’année 1917, les efforts du Gouvernement provisoire, puis ceux des Bolcheviks, pour maintenir une structure fédérale dans le Caucase russe, étaient voués à l’échec. La Diète (Seim), constituée au début de 1918, eut beau promulguer, le 22 avril, l’indépendance de la Fédération transcaucasienne, les nationalités de la région avaient des intérêts trop divergents pour maintenir cette unité. La Géorgie, puis l’Azerbaïdjan, déclarèrent leur indépendance, les 26 et 27 mai 1918. L’Arménie se trouva donc indépendante de facto, le 28 mai. Mais le Comité national arménien était si anxieux de la situation qu’il attendit jusqu’au 30 mai pour se déclarer « seule autorité suprême sur les provinces arméniennes ».
La fixation des frontières entre les trois nouveaux États indépendants fut un processus chaotique et tumultueux, à cause des derniers soubresauts de la Guerre mondiale, du conflit des nationalismes locaux, de la Révolution russe et du Pacte entre Kémalistes et Bolcheviks. Dans un premier temps, pour tenter de récupérer Batoumi, occupé par les Turcs depuis le 15 avril 1918, la Géorgie s’allie à l’Allemagne, elle-même alliée aux Ottomans. De leur côté, les Azéris placent tous leurs espoirs territoriaux dans l’avancée ottomane, mais le 30 octobre le sultan capitule, et le 11 novembre, sur le front occidental de la guerre, les Allemands signent l’armistice. On aurait pu supposer que la victoire des Alliés aurait été favorable aux Arméniens, restés seuls fidèles à leur camp.
Plusieurs raisons vinrent s’y opposer. Tout d’abord les vainqueurs, soucieux de fixer les nouvelles frontières européennes, ne prirent d’abord aucune décision définitive concernant le théâtre oriental de la guerre. Dès que les Britanniques furent chargés d’occuper le Caucase, sans savoir encore comment tournerait la révolution bolchévique, ils multiplièrent les concessions à leurs anciens ennemis, Géorgiens et Azéris, de façon à ménager leurs intérêts stratégiques et commerciaux sur l’axe pétrolier, Bakou-Batoumi.
C’est probablement ce qui incita le général W. M. Thomson à bloquer, aux abords de Šuši, vers novembre 1918, la milice arménienne d’Andranik, venu secourir ses compatriotes du Karabagh, occupé par Cemil Cavid bey depuis le 8 octobre. Dès lors, le territoire fut perdu pour les Arméniens, et gagné à l’Azerbaïdjan. Avant et après la soviétisation du Caucase, les dirigeants bolcheviks firent aux Arméniens, en sens contraire, des promesses qui ne furent pas tenues. En fait, ils ne jugèrent pas opportun de remettre en cause les arbitrages des occupants britanniques.
De même, en 1919, lors de la guerre arméno-géorgienne, le général britannique, W. H. Rycroft, imposa aux belligérants un partage de la province arménophone du Lori (sud-est de Tbilisi), qui fut plus tard entériné juxta modum par le régime soviétique.
*
L’imbrication inextricable des langues et des cultures subcaucasiennes rend géographiquement et administrativement impossible l’implantation de chaque ethnie (nombreuse ou résiduelle) dans un territoire distinct. Partout, on doit s’attendre à voir subsister côte à côte des monuments ou des vestiges d’époques et d’origines variées, qui méritent l’intérêt des archéologues, des historiens, des promeneurs, et nourrissent, bien souvent, la vénération de certaines communautés locales.
Nous sommes conviés aujourd’hui à rechercher quelques principes qui permettraient, éventuellement, de dépasser les clivages humains, politiques ou ethniques, afin de préserver, dans une perspective historique et artistique, tous les monuments et sites patrimoniaux de Subcaucasie.
Est-ce le moment d’engager un tel débat, au lendemain d’un conflit douloureux qui a suscité plusieurs semaines de combats acharnés, avivé les passions, entraîné la mort de milliers de victimes, détruit des monuments importants, laissé deuils et ressentiment du côté des vaincus, soulagement et exaltation patriotique du côté des vainqueurs ? Il est impossible de rester insensible à la douleur des familles, à la détresse des populations sinistrées ou déplacées. Mais le deuil et les larmes ont souvent la propriété de briser la cuirasse d’habitudes et d’indifférence, dont chacun s’enveloppe pour se prémunir contre les vicissitudes de l’existence. On ouvre alors les yeux sur les nécessités vitales. On retrouve la souplesse intellectuelle qui permet de remettre en cause les routines ou les préjugés invétérés.
La culture a ses propres arguments, qui reposent, non sur l’obligation ou la contrainte, mais sur la persuasion et le libre consentement de chacun. C’est pourquoi, bien que les droits des personnes et des États doivent toujours être scrupuleusement respectés, il vaut peut-être mieux limiter l’élaboration de nouvelles normes légales et s’abstenir de judiciariser les désaccords. Certes, on ne peut que s’incliner devant la jurisprudence de la Cour internationale des droits humains, qui a récemment sanctionné, comme un crime de guerre, la destruction de sites et de monuments historiques. Mais ce genre de mesures répressives est, au fond, un constat d’échec, qui ne répare pas les dommages causés et risque parfois d’approfondir le conflit de civilisations à l’origine de ces destructions.
On peut former le vœu, pour l’instant utopique, que chaque communauté se convainque que la meilleure garantie de survie de son propre patrimoine est le respect absolu du patrimoine des autres. Le premier effort que cela implique, et sans doute le plus éprouvant, est de faire abstraction, par principe, de tous les cas connus de patrimoines détruits. Abstenons-nous de citer des exemples précis. Admettons simplement qu’à des degrés divers, chacun des trois États subcaucasiens peut se reprocher des détériorations volontaires ou des destructions totales aux dépens de ses deux voisins.
Certains de ces faits sont chronologiquement si proches et si présents à la mémoire de tous qu’il est impossible d’exhorter quiconque à les oublier. La mémoire est un des devoirs imprescriptibles de la conscience humaine. Mais le silence qu’on s’impose à soi-même dans l’épreuve n’est ni amnésie, ni amnistie. C’est un acte de piété, une offrande à la paix, un sacrifice pour l’avenir. On évite de se reprocher mutuellement des faits irréparables, dont la simple évocation suffirait à entraver tout progrès ou tout projet dans les rapports futurs.
Les principaux obstacles à l’adoption d’un tel principe tiennent à la défiance intercommunautaire et à la fonction topologique ou, si j’ose dire, chorographique des monuments. Certes, il est impossible d’effacer, d’un coup, des décennies ou des siècles de défiance. Mais on peut, malgré tout, dialoguer et se mettre d’accord sur des choses simples. Cela peut servir d’amorce à des conversations plus importantes.
Ce qui fait tout le prix des monuments, c’est leur lien avec les sites où ils se dressent et la relation historique ou actuelle qu’ils entretiennent avec les collectivités qui les ont bâtis. C’est pourquoi on a tendance à les ressentir comme des marqueurs du territoire, des signes qui modulent ou organisent l’espace, des lieux parfois disputés entre plusieurs communautés. Par conséquent, pour couper court à toute revendication future, ceux qui se rendent maîtres des lieux, à un moment donné, décident souvent de supprimer ces témoins des époques passées.
En réalité, aucune communauté ne peut s’abstraire du passé, ni de l’environnement de son territoire. Nulle part il n’existe de sol vierge ni d’espace exclusif. On ne peut écrire sa propre histoire, sans l’inscrire dans la mémoire d’une humanité multiple et unique à la fois. Dans cette perspective, les vestiges et les monuments d’origines et d’appartenances différentes se répondent les uns aux autres pour retracer des histoires nationales reliées à celle de l’humanité tout entière.
Assurément, chaque peuple comprend instinctivement, mieux que tous les autres, le langage esthétique de sa nation. Le seul fait de savoir nommer dans sa langue toutes les composantes d’un édifice, d’en décrire adéquatement la structure et les ornements, pose déjà les principes d’un déchiffrement symbolique, présente la clef du décor, figuratif ou abstrait. Mais, au fil des siècles et des millénaires, tout style national s’enrichit d’inventions nouvelles ou d’emprunts étrangers soigneusement réinterprétés. Les vicissitudes du temps changent l’environnement culturel, sociétal ou humain. Parfois, certains vestiges tombent en déshérence par l’extinction complète des peuples qui en furent à l’origine.
C’est pourquoi les antiquités les plus vénérables pourraient servir d’emblèmes communs aux trois États subcaucasiens. Certes, le site de Tigranakert du Caucase, près de Hadrout en Azerbaïdjan, renvoie à la figure d’un illustre monarque arménien du Ier siècle avant notre ère. Mais Tigrane avait passé les 40 premières années de sa vie comme otage à la cour des Parthes, et les architectes auxquels il s’était adressé pratiquaient un art largement international, d’un bout à l’autre de l’Empire d’Alexandre. De plus, la cité qu’on a exhumée, au pied de l’acropole, est au moins 600 ans plus jeune que celle-ci. C’est un des rares sites où l’on peut observer directement, sur un territoire assez étendu, les vestiges du royaume d’Albanie, la plus ancienne structure étatique sur le sol de l’Azerbaïdjan.
Il y a évidemment lieu de comparer l’église et les édifices urbains de Tigranakert à l’ancienne église albanienne de Kish, près de Sheki. Mais on pourrait aussi penser à plusieurs constructions géorgiennes et arméniennes des IVe et Ve siècles. Ce pourrait être la matière d’une recherche transnationale sur le patrimoine subcaucasien, qui susciterait des fouilles, des conférences et des publications communes. D’une façon plus générale, il y aurait un grand intérêt à dresser un inventaire monumental et une typologie des très nombreuses forteresses et fortifications subcaucasiennes.
L’avantage de tels programmes, comparables à certaines actions entreprises par la fondation Aliph, est qu’on peut les mettre en place d’une façon purement factuelle, en coupant court aux discussions préalables. À quoi bon s’affronter sur les principes, quand on peut engager une coopération pratique, reposant sur des bases scientifiques et techniques reconnues par toutes les parties ? Ce genre d’échanges conduit nécessairement à une approche plus ouverte et plus respectueuse de toutes les époques et de toutes les cultures. Puisse-t-on ainsi contribuer à rassurer le public, à écarter les craintes et les soupçons injustifiés, à créer les conditions d’un code de conduite librement accepté par tous, sur la protection des monuments, des vestiges et de tout ce qui constitue le patrimoine millénaire de la Subcaucasie !
